Encore une fiction ? Qui plus est, encore une autrice que la moitié d’entre vous doit déjà connaître ? On dirait bien. Mais comme il y a quinze jours, ce pur roman n’en demeure pas moins une véritable quête mémorielle.
Ce livre, c’est « l’art de perdre », signé Alice Zeniter, l’histoire d’un harki qui n’a pas choisi le bon camp. Comme la plupart des Algériens, l’homme est plutôt favorable à l’indépendance, mais il a peur que le nationalisme éteigne la culture kabyle, il n’aime pas les barbus, il n’aime pas la violence, il n’aime pas que les prolos s’attaquent à son confort de notable… alors il finit par faire des choix discutables. Et sa famille les paie sur plusieurs générations.
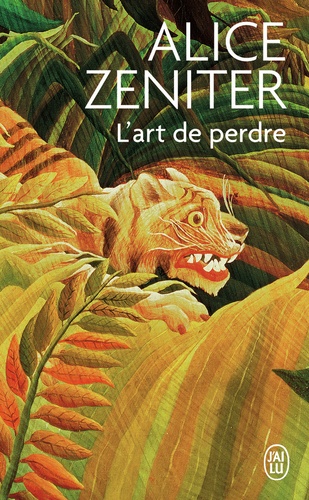
Pour ceux qui en doutaient encore, « l’art de perdre » rappelle que le roman est un bon moyen de découvrir des pans entiers d’histoire (pour moi, les harkis, c’étaient les Algériens combattant avec les Français, point barre). Ce n’est pas un travail savant bien sûr. C’est la petite étincelle dont on a parfois besoin pour creuser un peu plus.
Quête mémorielle
Au-delà de ça (et du plaisir simple de la lecture), on saisit assez vite qu’Alice Zeniter utilise la fiction pour raconter l’histoire de sa famille. Pas la vraie histoire, mais une possibilité d’histoire. Toujours cette quête des origines qui nous aide à trouver notre identité.
Il n’y a pas si longtemps, une membre de mon association de biographes s’étonnait de la demande d’une personne souhaitant une version romancée de l’histoire qu’elle avait à raconter. « Une démarche qui pose question », notait ma consœur. De fait, je ne sais pas si le biographe est le plus qualifié pour ce travail. Moi, j’adorerais partir d’un témoignage et remplir les interstices ou extrapoler des traits de caractères pour en faire une fiction. Mais suis-je légitime pour ça ?
Quoi qu’il en soit, Alice Zeniter montre que chercher ses origines par le travail romanesque est une option. Elle la justifie dans cette interview de Télérama qui remonte à 2017. « J’ai décidé de préserver ceux qui n’avaient pas envie de parler, qui prétendaient ne pas se souvenir. Si j’avais voulu faire une enquête sur ma famille, il aurait fallu que j’insiste, que je force. L’option romanesque me permettait de les laisser tranquille ». Elle souligne au passage qu’une fois le livre achevé, la parole de ses proches a commencé à se libérer. « Je ne regrette pas que les choses se passent dans cet ordre-là ».
Puisqu’on parle de Télérama – désolé pour ceux qui savent déjà et me voient arriver avec mes sabots taille XXL – c’est un petit T pour l’homme, mais un grand T pour un abonné à ce magazine depuis dix-huit générations, j’ai eu le droit, la semaine dernière, à un petit laïus sur mon podcast (dont j’ai parlé là).
Pour fêter ça (et la journée internationale sans téléphone mobile du 6 février), mon stagiaire de troisième vous a concocté une deuxième bande annonce pas piquée des vers, comme dirait Eric de mon deuxième épisode. Je la mettrai en ligne ce soir à 18 h. Si les choses sont bien faites, vous lisez « vidéo privée » ci-dessous, mais à 18h, elle apparaîtra par magie alors il faudra revenir ! (Sinon, vous la trouverez sur Youtube ou en version audio sur votre plateforme d’écoute préférée).
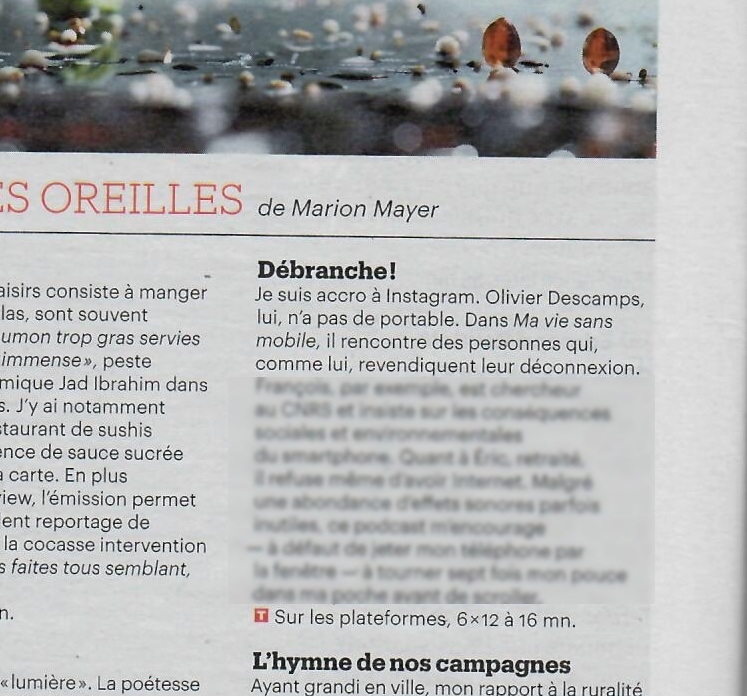
Partager :
- Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
- Partager sur Bluesky(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Bluesky
- Partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
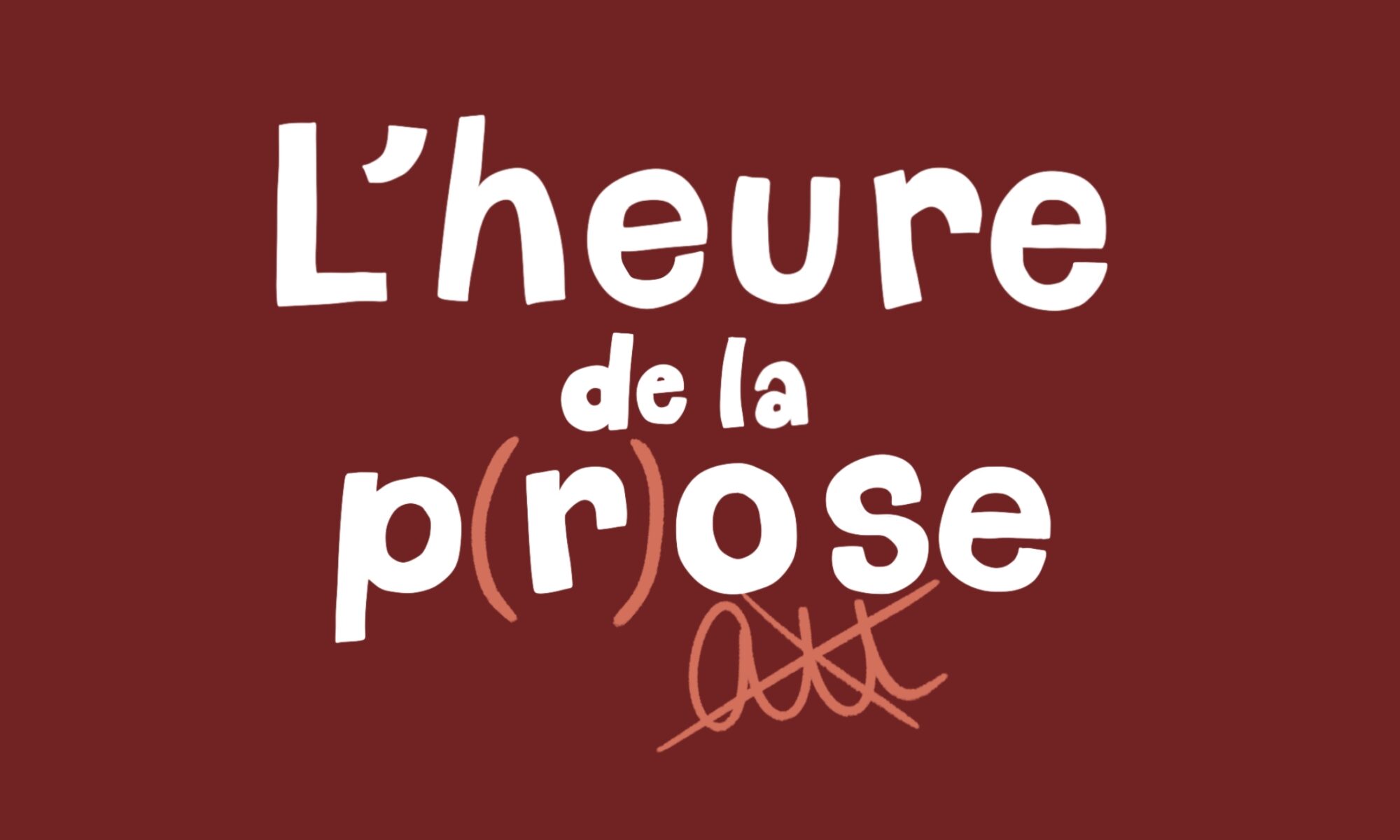
Bravo ! Finalement c’est top de te faire découvrir des livres, car on en a ensuite une critique parfaite, idéale à partager 😊
Et vivement 18h !
Pour d’autres cadeaux, t’as mon adresse !!